La prise en compte de la RSE n’est plus simplement un choix, mais une nécessité impérieuse. La Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) émerge comme un pilier essentiel de cette dynamique et doit être intégrée profondément dans la culture organisationnelle. Au cœur de cette intégration se trouve l’implication des parties prenantes. Leur participation active est bien plus qu’une simple formalité.
Lorsqu’il s’agit de naviguer dans les nuances de la responsabilité sociale et environnementale, les parties prenantes – qu’elles soient internes ou externes à l’entreprise – jouent un rôle pivot. Leur engagement offre une perspective précieuse sur les enjeux éthiques, environnementaux et sociaux auxquels une entreprise est confrontée. De plus, en les incluant dans le processus de décision, les organisations peuvent co-créer des stratégies RSE qui sont non seulement pertinentes, mais aussi durables à long terme.
Avec notre partenaire Act For Now, nous vous proposons un webinaire de 30 minutes qui vous livre 5 bonnes pratiques pour impliquer vos parties prenantes et répondre aux enjeux de la Directive CSRD 📹
Directive CSRD : Les intervenants du webinaire
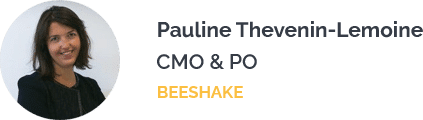
Spécialiste des stratégies d’engagement, Pauline a passé plusieurs années à écouter et conseiller les clients de Beeshake. Elle pilote aujourd’hui le développement de nouvelles fonctionnalités, et participe activement à l’accompagnement de nos clients. Pauline privilégie toujours une approche humaine, et conseille des plans d’action efficaces pour faire émerger des projets innovants tout en valorisant les personnes qui en sont à l’origine.

Issue d’une formation en management de la RSE, Estelle accompagne les organisations depuis 2 ans à l’accélération de leur démarche RSE (sensibilisation – formation – plan d’action – reporting). La montée en puissance de la réglementation en lien avec un engagement socio-environnemental, rend son travail d’accompagnement d’autant plus stratégique. C’est avec plaisir qu’elle vous livrera ses clés de compréhension de la toute nouvelle CSRD en lien avec la mise en action collective.
Directive CSRD : les objectifs de la réglementation
Nous allons d’abord replacer le contexte, notamment le contexte européen. La CSRD est conçue pour s’intégrer à travers des objectifs clairs. Un de ces objectifs découle de l’Accord de Paris de 2025. Celui-ci vise à limiter le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré d’ici à 2100. Pour y parvenir, un objectif de neutralité carbone d’ici à 2050 a été établi. Ces cibles ont été incorporées dans le cadre du Green Deal européen. Celui-ci inclut également un objectif transitoire pour 2030 consistant à réduire de 55 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 dans l’UE.
Pour réaliser ces objectifs, plusieurs réglementations ont été mises en place pour leur mise en œuvre. Parmi celles-ci figurent la CSRD, la SFDR et la Taxonomie européenne, qui vise à définir ce qu’est une activité durable à travers six grands objectifs. Si une activité est conforme à la Taxonomie, elle devra respecter des exigences en matière de reporting. Et notamment en ce qui concerne la décarbonation et l’adaptation aux changements climatiques. Ces informations devront être incluses dans le rapport de durabilité lié à la CSRD. Quant à la SFDR, elle exige que chaque investisseur déclare s’il souhaite investir dans des produits financiers durables.
Pourquoi les entreprises doivent-elles se préparer à la Directive CSRD ?
- Anticiper les débats sociétaux est une étape cruciale en préparation de l’exercice CSRD. Cela implique une surveillance attentive pour saisir les grandes tendances émergentes et s’y adapter. Il est essentiel de repérer les impacts, les risques et les opportunités pour l’entreprise. Et ce, à tous les niveaux de sa chaîne de valeur.
- Obtenir une vision exhaustive des questions ESG qui concernent l’entreprise constitue le cœur même du concept de double matérialité. Celle-ci sera complétée avec d’autres référentiels déjà existants.
- Repérer et exploiter les signaux faibles nécessite une interaction étroite avec les parties prenantes internes et externes. Maintenir un dialogue constant avec les parties prenantes les plus stratégiques permet d’engager une réflexion continue et anticipative. Et ce, afin de s’adapter aux évolutions et de devenir une entreprise de solution plutôt que de problème.
- Initier ou renforcer la communication avec les parties prenantes est crucial. Beeshake propose des solutions particulièrement intéressantes à cet égard, que vous pourrez découvrir lors dans le replay.
- Adapter la stratégie globale de l’entreprise est nécessaire pour garantir sa résilience à long terme.
L’intelligence collective pour la CSRD : un enjeu de mobilisation
La mise en œuvre de la CSRD représente un défi de taille. Un important processus d’acculturation s’avère nécessaire pour comprendre l’ampleur et la raison d’être de cette démarche. Il est essentiel de revisiter les fondements et l’urgence de cette exigence, liée à la crise climatique et environnementale actuelle.
Il est crucial d’éviter de se concentrer exclusivement sur l’aspect formel de l’exercice au détriment de la dynamique globale de la stratégie RSE. La conception et le déploiement d’un plan d’action sont incontournables. Il faut donc capitaliser sur les ressources internes, notamment les ambassadeurs, pour faciliter le déploiement.
L’enjeu réside dans la nécessité de mobiliser toutes les parties prenantes de manière transversale. Il est important d’abandonner la vision en silo traditionnelle. Chaque département, chaque fonction doit contribuer à la collecte d’informations, en commençant par le top management. Celui-ci doit définir une vision et une trajectoire en adéquation avec les objectifs de la CSRD et les enjeux stratégiques.
Directive CSRD : rendre votre stratégie RSE crédible et concrète
La Directive CSRD, bien au-delà d’une contrainte, représente une opportunité essentielle pour les entreprises de développer une vision plus large de leur responsabilité sociale et de renforcer à la fois leur crédibilité et la concrétisation de leur stratégie RSE à travers différents piliers :
- L’acculturation : Ce pilier consiste à familiariser l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise avec les concepts et les objectifs de la stratégie RSE. Il est crucial que tous comprennent les enjeux et les valeurs portées par cette démarche pour pouvoir l’adopter pleinement.
- L’échange bidirectionnel : Maintenir un dialogue ouvert et régulier entre les différentes parties prenantes et la direction RSE est primordial. Cette communication bidirectionnelle permet de garder le lien, d’identifier les besoins et les attentes des parties prenantes, mais également de transmettre les avancées et les résultats de la stratégie RSE. Mettre en place une démarche à la fois descendante (top-down) et ascendante (bottom-up) favorise une meilleure compréhension et une adhésion plus forte à la stratégie RSE.
- L’appropriation : Il est essentiel que les parties prenantes puissent contribuer activement à la mise en œuvre concrète de la stratégie RSE de l’entreprise. Leur permettre de proposer des actions et des initiatives concrètes renforce leur implication et leur sentiment d’appartenance à cette démarche. Cela peut se traduire par des programmes de participation, des consultations régulières ou encore des dispositifs d’incitation à l’innovation sociale au sein de l’entreprise.
[Lire aussi : Mettre en place une stratégie RSE avec vos collaborateurs]
Directive CSRD : 5 bonnes pratiques pour impliquer les parties prenantes
Bonne pratique n°1 : Acculturer en continu
Il est essentiel de garantir une compréhension commune en continu. Cette intégration culturelle peut se réaliser à travers divers formats, tels que le partage de veille, d’articles, de commentaires sur l’actualité, des sessions en présentiel comme des ateliers etc.
Un exemple intéressant est celui des ateliers sur les fresques du climat, où les participants peuvent non seulement prendre part, mais aussi être formés pour devenir animateurs. Ainsi, il existe une logique dans la propagation de cette acculturation grâce à l’implication des participants.
Cette même approche peut être appliquée à d’autres contenus. Par exemple, dans le cadre de parcours de MOOCs, une méthode d’acculturation courante, en proposant des parcours permettant aux individus de s’approprier les concepts. On peut aussi envisager d’identifier des experts qui pourraient ensuite proposer des parcours à la communauté, permettant à chacun de partager son expertise sur divers sujets. Ainsi, l’acculturation ne se limite pas à un processus descendant, mais peut également se diffuser de manière horizontale.
Bonne pratique n°2 : Créer des rituels pour garder vos parties prenantes intéressées
Lorsqu’on évoque l’engagement, il est bénéfique d’adopter une approche rituelle pour impliquer les parties prenantes. Ces rituels peuvent revêtir diverses formes et s’inscrire harmonieusement dans le cadre du dialogue avec les parties prenantes.
Ils peuvent être tant des rituels top down, tels que le partage hebdomadaire ou mensuel d’interviews ou d’articles de veille, que des rituels bottom up, comme une enquête mensuelle ou un sondage hebdomadaire. Tous ces formats contribuent et permettent de prendre le pouls. La mise en place de rendez-vous réguliers constitue une méthode efficace pour engager les parties prenantes.
Pour découvrir les 3 autres bonnes pratiques, découvrez le replay en intégralité
